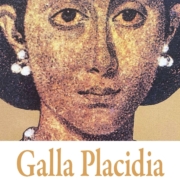Ce que le christianisme a à me dire aujourd’hui
 Le premier message que me donne le christianisme c’est l’existence de chrétiens. Qu’ils soient proches des instituions ou éloignés, ils m’importent au plus haut point. Ces chrétiens, je leur demande surtout d’être. Ni dans la performance éthique, ni dans une identité ostentatoire, mais dans la quête. J’ose à peine dire « quête de Dieu ». Car nommer Dieu c’est sans doute déjà trop. Alors que dire :« la quête », peut déjà désigner Dieu. Aussi, que plus de 40% des Français se disent catholiques sans pratiquer, cela peut être le signe d’un désintérêt, mais aussi d’une insatisfaction devant ce qui leur est offert, d’une quête encore souterraine. La discrétion actuelle est peut-être de très bon augure, dans la mesure où elle traduit que nous sommes lassés d’un Dieu manipulé à des fins mondaines et que nous attendons peut-être une nouvelle révélation de Dieu.
Le premier message que me donne le christianisme c’est l’existence de chrétiens. Qu’ils soient proches des instituions ou éloignés, ils m’importent au plus haut point. Ces chrétiens, je leur demande surtout d’être. Ni dans la performance éthique, ni dans une identité ostentatoire, mais dans la quête. J’ose à peine dire « quête de Dieu ». Car nommer Dieu c’est sans doute déjà trop. Alors que dire :« la quête », peut déjà désigner Dieu. Aussi, que plus de 40% des Français se disent catholiques sans pratiquer, cela peut être le signe d’un désintérêt, mais aussi d’une insatisfaction devant ce qui leur est offert, d’une quête encore souterraine. La discrétion actuelle est peut-être de très bon augure, dans la mesure où elle traduit que nous sommes lassés d’un Dieu manipulé à des fins mondaines et que nous attendons peut-être une nouvelle révélation de Dieu.
Je pourrais aussi longuement parler des réussites du christianisme, réussites éthiques, enseigner, guérir, libérer, défendre la dignité humaine, presque instaurer les Droits de l’homme, et parler des réussites théologiques, cette quête du Dieu de Jésus, cet élargissement de l’espace de nos tentes.
Je choisis de le faire à partir des évangiles, écrits par des témoins, pour que nous soyons des témoins. J’en découvre chaque jour la nouveauté et la fraîcheur. Tout m’y semble neuf. « Neuf », est-ce le bon terme ? Les évangiles ont été lus et relus, pressés de livrer tous leurs sens. Mais sachons que, lorsque le texte ne confortait pas les attentes, ses lecteurs s’en sont purement et simplement détournés. Le contenu des évangiles a bien été identifié, mais il n’a pas été « exploité », mis en pratique.
Qu’a-t-on voulu voir ? Qu’a-t-on favorisé en lisant l’Évangile ?
1.l’Eglise a pactisé avec le pouvoir temporel
elle a surtout voulu l’exercer « en direct ». On se souvient de la profonde dépression vécue par le Vatican après la perte des États pontificaux, en 1870, qui a duré jusqu’au concile de Latran, en 1929. Elle atteste du choc subi par la perte de son pouvoir. C’est aussi pour sauvegarder un pouvoir que l’Eglise catholique « a fait » la Réforme, de toutes pièces, en refusant la très catholique protestation de Luther, au nom d’une obéissance hiérarchique totalement étrangère à l’Évangile.
2.L’Eglise a cherché d’inutiles querelles au monde.
Elle a cherché querelle à la science, à la médecine, puis à la sécularisation, puis à la modernité, dans la crise moderniste, puis à la psychanalyse, puis elle a ignoré l’émancipation des femmes, ce qu’elle paie cher aujourd‘hui.
3.L’Eglise a surtout détourné l’Évangile dans le choix de sa structure institutionnelle.
-Cette structure institutionnelle s’est créée en un temps de régime patriarcal. L’Évangile a donc été lu avec des lunettes patriarcales. Sachons qu’il n’y a pas de prêtres dans le Nouveau Testament. Celui qui annonce l’Évangile, il fait partie du peuple. Les Douze ne sont pas les « premiers prêtres », ni les premiers évêques. Il n’y a pas de prêtres (sacer) dans la jeune Église chrétienne, avant 250 ap. J. C. Il faut bien voir que les Douze ne sont pas une élite de Douze hommes choisis du milieu d’une foule anonyme. Ils sont Douze parce qu’Israël compte douze tribus. Par conséquent, appeler douze hommes, cela signifie appeler la totalité du peuple : le contraire d’une sélection ! Par ailleurs, lorsque s’est mise en place une ébauche d’ecclésiologie, vers le 3e siècle, les Douze, corps qui s’est constitué en « successeurs des apôtres », a exclu le peuple de l’héritage, celui de gouverner l’Église. Il y a eu, au sens fort du terme, détournement d’héritage, comme c’est par exemple arrivé de façon plus visible entre les descendants de Mahomet.
-L’Évangile a été détourné vers le patriarcat, moyen d’exercice de la domination masculine. Phénomène classique, les commentateurs commentent avec le prisme de leur condition et de leur milieu. Une Église masculine a masculinisé l’Évangile, en s’appuyant sur le patriarcat. Or, Jésus dit. « N’appelez personne ‘Père’, car vous n’avez qu’un père, qui est dans les cieux ». Les membres des ordres mendiants, prêcheurs et franciscains, ont eu beau se faire appeler « frères », l’appellation « père » a repris le dessus, parce qu’ils sont aussi prêtres, et que la sacralité du prêtre implique une relation de supériorité de type patriarcal.
-L’Évangile a été détourné parce qu’on en a gommé les femmes, dangereuses pour le célibat, donc hâtivement considérées comme de mauvaise vie, alors qu’il n’y a dans tous les évangiles qu’une femme dont on pense qu’elle était une prostituée. De cette épuration ethnique, il n’est resté d’honorables que Marie, et les deux sœurs, Marthe et Marie. Marie a été défigurée. Et les autres femmes ont été, au fil des siècles, écartées de l’annonce de la résurrection dont elles étaient pourtant les premières témoins.
-L’Évangile a été détourné parce que son fondateur s’est battu contre l’exclusion, celle des lépreux, des publicains, des femmes, des gens de mauvaise réputation, et que l’Église, dès le 2nd siècle, devant la première hérésie, celle de Marcion, a commencé à exclure. Et aujourd’hui, elle ne fonctionne plus que comme une machine à exclure.
-L’Évangile a été détourné de son ambition de désacralisation du monde, largement commencée avec les prophètes. Jésus a lui aussi désacralisé le monde, en particulier le temple, pour se focaliser sur le seul sacré chrétien : le visage de l’autre. Or, l’Eglise a recréé du sacré, ce qui renforce un pouvoir.
-L’Evangile a été alourdi, presque contrefait, par des extensions dogmatiques. Etaient-elles toutes nécessaires ? Certaines, sans doute. Mais peut-peut-on en dire autant des dogmes mariaux de 1854 (Assomption) et 1950 (Immaculée conception) ? Je souligne que la grande période du dogme a commencé avec la reconnaissance du christianisme par le pouvoir romain. Le premier grand concile de l’Église, celui de Nicée en 325 suit de dix ans seulement la reconnaissance du christianisme par l’empereur Constantin, et c’est l’empereur lui-même qui l’a convoqué. N’y aurait-il pas une collusion objective entre des vérités dogmatiques à croire » et l’exercice d’un pouvoir ? Petit à petit, le dogme a pris le pas sur la Parole et il a fini par devenir presque plus important que la parole évangélique elle-même. Au lieu de soutenir la parole évangélique, de l’expliquer, trop souvent il la voile. En tous cas, il a contribué à en détourner les fidèles qui, aujourd’hui, l’acceptent très difficilement. Le christianisme est devenu une doctrine (c’est encore le terme utilisé par Vatican II) alors qu’il est un art de vivre, comme le souligne Joseph Moingt.
Ces détournements, en gros, vont toujours dans le même sens : ils consolident la place de l’institution au détriment de la parole évangélique. On en oublie que l’Église-institution doit tjs rester au service de l’Évangile. A cause de tout cela, les évangiles tels que l’institution les utilise actuellement ressemblent à ces manuscrits anciens sur lesquels on a écrit un autre texte et qu’on appelle des palimpsestes.
Que découvre-t-on dessous ?
1-Sous la construction de pouvoir, sous cette « chrétienté », ce système plein, clos, totalitaire, dont on ne peut pas sortir, on découvre que, pour Jésus, la vérité (religieuse, non la vérité scientifique) ne se possède pas, mais se construit au creux des relations. Il n‘y a donc pas lieu d’exercer un pouvoir, puisque tout pouvoir altère la qualité des relations, donc nuit à la vérité.
2-Sous les relations verticales induites par le patriarcat, on découvre l’horizontalité de la fraternité. Jésus est le frère par excellence. Chez lui, nul appétit de pouvoir, aucune volonté d’emprise sur autrui. Jésus, c’est le service de l’autre dans toute sa pureté. Il informe, enseigne, soulage, guérit, tend la main à tout être humain, mais laisse libre. Il rend tous les êtres humains « enfants de Dieu », comme le dit Jean (1 Jn 3). Nous sommes enfants de Dieu, frères et sœurs, non seulement par l’existence d’un Père du ciel, mais surtout par la Croix. Pourtant, nous savons que, si la fraternité est au centre du ministère de Jésus, elle reste la vertu la plus difficile à vivre. Ce n’est pas pour rien que l’institution-Église, prise dans des jeux de pouvoir, a tenté d’écarter l’injonction de fraternité de la Bible, exprimée au tout début de la Bible avec l’épisode de Caïn et Abel, et où apparaît le mot « péché » pour la première fois. Les entorses de l’institution à la fraternité étaient si nombreuses que mieux valait ne pas trop en souligner la primauté.
3-Sous la férule masculine, on redécouvre qu’il y a des femmes dans les évangiles (Jean, Luc). Marie de Magdala, qui voit Jésus ressuscité, la Samaritaine et Marthe, théologiennes toutes les deux, l’une du désir de Dieu, l’autre de la résurrection, il y a Marie qui oint les pieds de Jésus, la Syrophénicienne, et Marie mère de Jésus, qui, avec le Magnificat, prononce le manifeste le plus subversif qui soit.
4-Sous des injonctions volontaristes ou politiques, on découvre une autre conception de la radicalité évangélique. Celle-ci ne consiste pas à faire la révolution, ni à renverser l’ordre social, ni à soutenir des contre cultures, ni à se sacrifier, ni à « porter sa croix » à la force du poignet, par un exercice de volontarisme. Mais elle demande que l’on désencombre son cœur, que l’on écoute autrui, qu’on se rendre intérieurement capable d’aimer ses ennemis, que l’on comprenne qu’un paumé de la rue a autant que moi part au Royaume de Dieu, et que je peux partager avec lui un peu de mon superflu. Dans la radicalité évangélique, il s’agit d’abord de faire ses choix d’homme ou de femme libre et responsable.
Ces divers items que je viens de rassembler pour notre propos sous-tendent le cœur du message évangélique, « le message de toujours ». Quel est-il ?
-Au niveau éthique, il est rassemblé dans les Béatitudes : humilité, attention à tous, sens de la justice, ouverture du cœur…
-Au niveau théologique, le cœur de l’Évangile, c’est le mystère pascal, mystère de mort et de Résurrection.
Comment ce message peut se dire aujourd’hui ? Comment nous rejoint-il ?
–Les Béatitudes, considérées comme le « programme politique de Jésus », ont un versant écologique qui me semble répondre à une forte attente actuelle. En effet, il y a une double insistance dans les Béatitudes. Un versant tourné vers des valeurs dites « faibles », comme la douceur, l’extériorisation de la peine, la pauvreté, la patience, la simplicité du cœur, l’intériorité. Ces valeurs ont été raillées, mais elles sont en voie d’être redécouvertes. Et il y a un versant eschatologique, avec le souci de la justice et de la paix, qui sont les horizons ultimes de toute action politique digne de ce nom. Ces valeurs sont très investies par les mouvements écologiques.
-Dans le mystère pascal, cœur du kérygme (l’annonce) faites par les disciples après la résurrection, il y a deux aspects. Il y a l’événement central, Jésus meurt et il est vu vivant le 3e jour. Et il y a la circonstance : la Pâque.
1.Mort et résurrection ne doivent pas être séparés. Pourquoi ? Parce que c’est dans la mort même de Jésus que germe la résurrection. Pour tenter d’y voir « un peu » clair, il est utile de s’approcher de cette mort, en chercher les causes, les modalités, la manière dont Jésus l’a vécue.
-Jésus ne meurt pas par hasard, même si, parfois, nous le souhaiterions ; ce serait si simple ! Non, Jésus meurt à cause de l’hostilité au bien des grands-prêtres du Temple. « Jésus a passé faisant le bien » (Actes 10, 38), soignant, enseignant, guérissant des démons, libérant de toutes servitudes. Tout ce ministère de bonté « se précipite », au sens chimique du terme, dans sa mort. Pourquoi être si hostile au bien fait par un homme sans pouvoir ? Écoutez la violence des critiques qui fusent contre les gens sans pouvoir mais dotés d’une forte autorité morale. Envers Gandhi, envers Martin Luther King, envers le pape François, par exemple. La raison de cette violence est simple : le refus du pouvoir est une menace terrible pour les gens de pouvoir. La contestation est trop radicale, elle sape « à la racine » toute justification du pouvoir. Elle rend visible ce qui manque aux gens de pouvoir : l’autorité morale, celle dont, précisément, Jésus est détenteur.
D’où vient que je reconnais à quelqu’un une autorité morale ? Sans doute parce qu’il allie en lui intériorité, c’est-à-dire la connaissance de soi, et altérité, c’est-à-dire empathie pour l’autre. Sa connaissance de lui-même lui a permis de se savoir faillible, enclin au bien comme au mal. De cette faiblesse, assumée, stimulante, lui vient une assurance sereine, une force que l’interlocuteur perçoit très bien et qui suscite la confiance. Quant au goût de l’autre, il pousse au bien, aux oeuvres de miséricorde, de pitié, de salut.
-Dans la contemplation de Jésus, cet homme sans pouvoir mais qui fait le bien, je reçois une précieuse leçon pour aujourd’hui. Qui sont les autorités morales de notre temps ? Une poignée de personnes : le pape François ; le Dalaï Lama ; Madame Merkel… D’autres aussi, dépourvus de célébrité, ont un rayonnement dans leur environnement familial ou social. Mais ils sont trop peu nombreux pour notre société en quête de figures d’étayage, par rapport au très grand nombre de gens de pouvoir qu’on donne trop volontiers en exemple.
Aussi, devant le refus du pouvoir de Jésus, je me demande à nouveau comment vivre sa vie d’homme ou de femme dans le service -qui construit l’autorité morale- et non dans le pouvoir. Cette question est de celle qui ne doivent pas nous lâcher.
-La mort de Jésus, cette croix qui est devenu le signe de reconnaissance des chrétiens, elle est l’acmé du don. Je ne peux pas donner plus que ma vie. La Croix est le lieu de l’amour total, celui qui ne retient rien par devers soi. Et cette réalité, pourtant vieille de 2000 ans, traverse les générations et m’atteint, moi aussi. Je peux donc dire que « le Seigneur m’a aimé et s’est livré pour moi ». Et redire, avec Jean : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ».
Ce geste de Jésus fait prendre conscience qu’il n’y a pas de société sans don. Ce geste est celui qui permet à une société de vivre. Je n’ai pas grandi sans que mes parents, ou l’État, ou une bonne âme, me donnent leur temps, leur enseignement, leur patience, leur argent, même. Si je refuse de donner, si je m’agrippe sur mon bien, et si je me bats pour le garder, ou si je veux ce qu’a l’autre, c’est la guerre. Sans don, nous nous entretuerions. Donner est vraiment le geste princeps de toute vie sociale. C’est la Loi en un seul article. Aussi, chaque fois que nous regardons une croix, n’y voyons pas d’abord le dolorisme, la souffrance, le volontarisme qui nous écartèle, mais le don. Si cela nous aide, remplaçons le mot « croix » par celui de « don ».
Oui, on refuse aujourd’hui de donner sa vie pour une cause, mais il existe aujourd’hui encore des gens qui la donnent, et l’opinion en écoute le récit avec une sorte d’avidité qui impressionne. Le colonel Beltrame, certains journalistes d’investigation qui se battent contre la corruption, par exemple… Et je crois que tous les parents donneraient leur vie pour leurs enfants.
Mais le don ne cantonne pas à cet exemple extrême. Donner se décline au quotidien, en de multiples petits gestes de don. Á commencer par la vie quotidienne en famille. Si je ne donne pas mon temps, ma patience, mon argent, il n’y a pas de vie possible.
Bien sûr, donner n’empêche pas la prudence, le discernement, etc. Donner ne doit pas être un geste « téméraire », mais « raisonné ». C’est parce que donner est la clé de la vie commune que donner fait vivre. Donner, c’est l’assurance de la vie possible. La résurrection de Jésus est donc ce qui arrive après le don/mort, » une mort « pour la vie », ou une mort « qui fait vivre ». Je n’ose pas dire que c’en est « la conséquence », car ce serait mettre la main sur les desseins de Dieu. Mais je peux dire que la résurrection est le fruit de la mort. « Si le grain ne meurt », dit Jean ….
2.Deuxième volet de ce mystère pascal, sa circonstance : il a lieu pendant la Pâque juive. Tous les évangélistes situent la mort de Jésus pendant la Pâque, avec une différence entre les synoptiques et Jean. Chez Jean, la mort de Jésus survient au moment où les agneaux sont égorgés au Temple. Pour lui, Jésus est l’agneau innocent. Sa Passion est une Pâque. Jésus est la Pâque.
Ceci nous amène à rappeler le sens de cette fête.
Pâques, vient de l’hébreu Pessah, qui veut dire « passage ». Cette fête est la fusion de deux fêtes ancestrales : une fête agraire et une fête de l’agnelage. Le judaïsme en a fait sa fête majeure. Elle célèbre un double passage : celui de Dieu qui, en venant frapper les Égyptiens est « passé » au-delà des maisons des Israélites (Ex 12, 27). Le passage fondateur est donc celui de Dieu. Ensuite, grâce à cette mansuétude divine, le peuple, guidé par Moïse, va pouvoir « passer » la mer à pied sec. Il va passer de l’esclavage à la liberté, dans une démarche de libération aux potentialités indéfinies. Nous naissons dans une libération, qui nous arrache au ventre maternel.
Puis, sur cette Pâque juive, s’est greffée la Pâque de Jésus, son passage vers son Père. Pour les évangélistes qui la racontent, elle est aussi l’accomplissement de la Pâque juive : ils veulent nous dire qu’à la Croix, Dieu passe. Il y a une révélation dans ces instants tragiques. Quant à la mort de Jésus, elle est libération, peut-être pour lui, mais en tous cas pour nous. En somme, Pâques, c’est Dieu qui passe et fait passer de la mort à la vie.
Pâques est donc la plus grande manifestation qui soit de « l’art de passer ». Et dans notre quotidien, nous en sommes les bénéficiaires permanents. En effet, ce verbe « passer » est l’un des plus utilisés de notre langue, et aussi dans d’autres langues : passover disent les Anglais. Il signifie que l’on a passé un cap : « Le bébé est bien passé », « Il est passé me voir ce matin », « la couleur des rideaux a passé », « j’ai passé mon examen », etc.
Pessah dit que nous sommes des passants sur cette terre. C’est notre définition, et cette définition nous met dans un perpétuel mouvement. Avec le judaïsme, qui a inventé l’histoire, nos vies sont dans une dynamique. Nous sommes plongés dans le temps. Passer est la dynamique de nos vies.
La leçon que j’en tire pour ma vie est que je rends grâce de ce qu’il m’est à moi aussi donné de « passer », de vivre, d’advenir, de me surpasser, de me faire « dépasser », et de trépasser.
Enfin, Pessah, Pâques est non seulement, non seulement la fête du passage de Dieu, non seulement une fête du passage de la Mer, non seulement la fête du passage de Jésus vers son Père, mais Pâques est le mouvement même de nos vies. Pâques nous exauce. Je crois qu’il y a une dimension anthropologique dans le mystère pascal. Nous portons ce mystère : nous sommes construits par le moule de Pâques, et nous l’actons dans notre vie. Sans cesse nous mourons et renaissons. Sans cesse nous donnons. Donc, nos vies seront déployées, heureuses, exaucées, même, au-delà de toute mesure, lorsqu’elles accepteront ce passage.
Ceci m’amène à reconnaître ce que je pense être la contribution majeure du christianisme à tous les temps, au nôtre en particulier : le christianisme dit qui est l’être humain : un passant, visité par Dieu, libéré par lui de ses esclavages les plus sournois. Le christianisme est une anthropologie.
Mais le don n’est pas le dernier mot de ce que le christianisme a à me dire aujourd’hui. Derrière le don de Jésus, il y a le mot de tous les dangers, le mot « amour ». Si Jésus donne, c’est par amour. La clé de la présence divine au monde, elle a été donnée depuis longtemps, dans la Torah et chez les prophètes Je la résume avec une simple phrase du prophète Isaïe que je réentends intérieurement chaque jour : « Tu as du prix à mes yeux et je t’aime » (Es 43, 4).
Quel est cet amour dont je suis aimée ? Il s’agit de cet amour inconditionnel que cherche tout être humain. Il peut prendre plusieurs formes.
-Il est d’abord la justification de ma propre existence. C’est cette justification qu’a découverte Luther dans sa tour, quand il a compris que l’amour de Dieu lui était donné sans contrepartie de sa part – finies les mortifications, la culpabilité dévorante que Luther subissait sans pouvoir connaître le repos… En somme, Luther s’est vu subitement comme la rose du Pèlerin chérubinique : un être sans pourquoi, justifié par son existence même, livré au monde -autant d’ailleurs à sa bonté qu’à sa fureur- mais un être libre, dont la liberté est à la fois l’essence et le moteur. Le cœur et le viatique.
-Il est ensuite la sécurité absolue : « Dieu mon rocher », dit le livre de l’Exode. Il est la Nuée au désert, présente au-dessus du petit troupeau qui déambulait dans les sables. La Nuée qui s’arrêtait le soir et repartait avec le peuple au matin. Et sa présence, sa seule présence, ou du moins la certitude de sa présence, devient notre force. Elle chasse la peur, la peur qui est si mauvaise conseillère. Pourtant, sous cette présence, tout le mal du monde peut encore advenir, tous les tourments aussi, mais Dieu reste là. Dieu ne protège pas du mal, qui reste subi, mais il délivre de son poison. Son poison, c’est de croire qu’il a eu le dernier mot. Le dernier mot, il a été à Dieu qui a ressuscité Jésus, vainqueur du mal. Sa simple présence doit nous suffire. Dieu n’a pas empêché D. Bonhoeffer d’être pendu. Mais il était avec lui dans la prison de Flossenbürg. C’est cette sécurité essentielle qui s’appelle « amour », car elle fait de nous des vivants, exposés à la dureté du monde, mais debout : « Ceins tes reins comme un brave » disait Dieu à Job avant de lui montrer sa puissance (Job 38, 3).
Faut-il Dieu pour cela ? Non, je dois reconnaître que Dieu n’est pas « nécessaire » à cette expérience d’amour. Si vos parents sont de bons parents, ou si vous être résilient, ou si vous rencontrez un bon psy, vous pouvez tout à fait tenir debout sans Dieu. Vous pouvez vous sentir libre, parfaitement libre, et en sécurité parce que vous avez confiance en vous. Et votre confiance en vous peut ne pas être égocentrisme, mais aussi confiance en l’autre, riche de mille dons, lui aussi. Et Dieu, alors, n’est pas nécessaire. Mais… revirement salutaire : Peut-être est-ce seulement à partir de ce moment que je peux commencer à aimer Dieu, dès lors qu’il ne m’est plus nécessaire ? Dieu devient mon choix, et je deviens le sien.
En quoi cet amour inconditionnel est une leçon pour aujourd’hui ?
Qui ne voit que nos sociétés ont besoin d’amour ? L’amour qui vient de Dieu chasse la peur, la peur omniprésente de nos sociétés, et la remplace par la main tendue, par un a priori de bienveillance. Je ne sais pas si Dieu existe, mais je sais que l’amour qu’il donne rend heureux.
Il y a donc des attentes contemporaines auxquelles le christianisme de toujours sait très bien répondre. Le christianisme subvertit les logiques de pouvoir, il prône une universelle fraternité, une foncière égalité entre les femmes et les hommes, et une saine écologie humaine. Pour moi, le christianisme est une anthropologie, il exauce le vivant. Il nous dit qui nous sommes.
Qu’est-ce que le vivant selon la Bible ? Un être créé bon et de la bonté divine, appelé à la liberté, capable de faire le mal, mais certain du pardon de Dieu, un être aimanté par la quête, et qui trouve son bonheur à reconnaître qu’il y a plus grand que lui. En somme, l’anthropologie biblique est bien résumée par ce mot célèbre de saint Irénée : « La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant. Et la vie de l’homme, c’est la vision de Dieu ».
En écho de ces lignes, je voudrais en conclusion, apporter le témoignage de trois jeunes auteurs ».
« La foi chrétienne exerce politiquement sa puissance de déflagration selon au moins trois axes. Elle désacralise et délégitime les pouvoirs mondains politique et économique en faisant du maître le serviteur. Elle nous ouvre à l’expérience de l’éternité, libérant nos vies de deux dangers jumeaux : la confiance irrationnelle dans l’avenir et la sacralisation d’époques anciennes, et nous fait accéder à l‘expérience du temps messianique et du salut. Elle ruine les prétentions du sujet à l’identité, l’ouvrant à la découverte en lui-même de l’altérité divine qui l’appelle au don de soi -ce qu’on appelle la charité- où s’expérimente la béatitude ».
Anne Soupa
Paul Colrat, Foucauld Giuliani, Anne Waeles, Éditions du Seuil, La Communion qui vient, Carnets politiques d’une jeunesse catholique, 216 p. ; Sept 2021 ; p. 10.